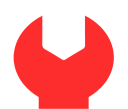
Le site Mosquée Taqwa
est en maintenance
Nous faisons un peu de maintenance sur notre site.
Ce ne sera pas long In sha Allah.
Revenez nous voir dans quelques jours. Merci de votre patience!
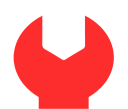
Nous faisons un peu de maintenance sur notre site.
Ce ne sera pas long In sha Allah.
Revenez nous voir dans quelques jours. Merci de votre patience!